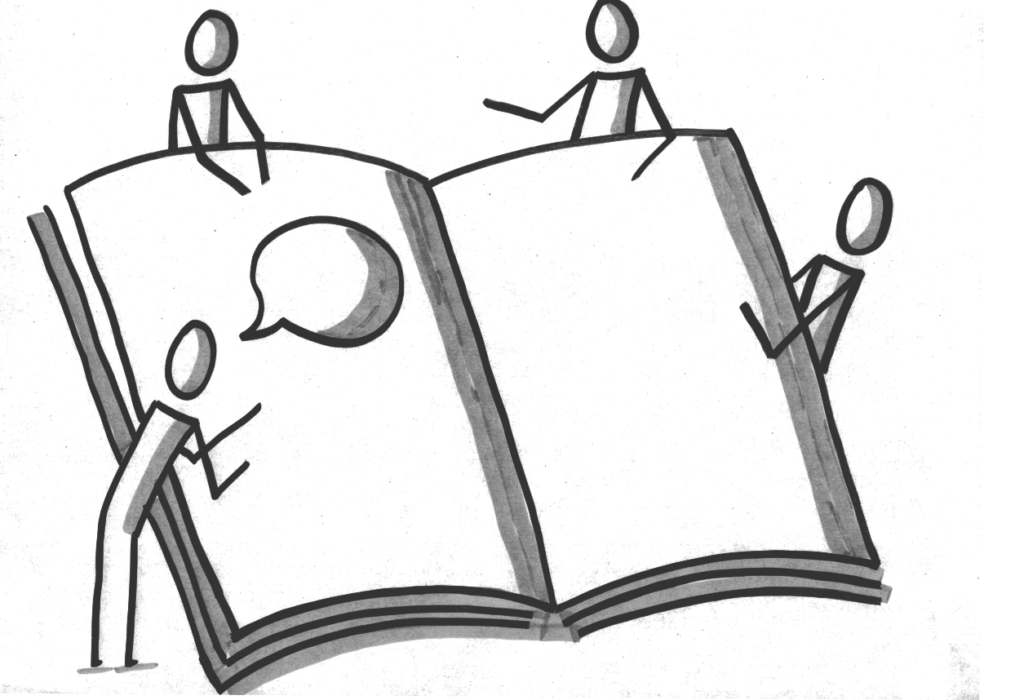
Présentation
Cette méthode s’est largement diffusée dans la société française depuis quelques années. Et tant mieux ! Mais, en se diffusant, comme souvent, cette méthode s’est rigidifiée, il y aurait ainsi une procédure à respecter pour faire un arpentage dans les règles de l’art. Et des mythes se sont construits autour de cette méthode, mythes qui renforcent l’effet de mode autour de l’arpentage.
Cette page vise à défaire ces mythes, et à présenter les principes de cette méthode, permettant à qui le souhaite de conduire des arpentages comme bon lui semble, en fonction du contexte, du public, des intentions… Bref, de remettre du mouvement, de la souplesse, de la créativité dans l’usage de cette méthode.
Intention
Lire un livre collectivement. Permettre à un groupe d’acquérir des savoirs communs, de s’approprier des références communes, et donc de sortir des dominations par le savoir, et à chacun, et surtout aux non-lecteurs, de s’offrir le luxe et le plaisir de découvrir des pensées, des auteurs ou des théories, qu’on ne serait pas allé chercher sans ça.
Cette méthode, en se diffusant, a tendance à devenir une « recette » d’animation dont l’intention devient de s’approprier le plus efficacement possible le contenu d’un livre. Cette recherche d’efficacité centre l’animation de la discussion sur « ce qu’il faut avoir compris » de ce livre, invitant les participants à faire, d’une manière ou d’une autre, un résumé du fond de ce que chacun a lu.
Le défaut de cette intention, c’est de reproduire un rapport scolaire à la lecture. Ce n’est pas forcément un problème si les participants n’ont pas souffert à l’école de ce rapport à la lecture et cherche effectivement à comprendre rapidement le contenu d’un livre.
C’est par contre dommage car l’Arpentage, animé autrement, permet d’ouvrir un autre rapport à la lecture, largement décomplexée par rapport aux souvenirs que beaucoup ont de l’école, faisant la part belle au plaisir de lire. Si un arpentage peut servir à s’approprier le contenu d’une œuvre, cette méthode peut aussi autoriser à en penser quelque chose, ce qui est différent. La suite de cette page est écrite dans cette seconde intention.
En effet, s’avouer collectivement qu’on ne comprend pas grand chose à un bouquin, critiquer un auteur en trouvant qu’il se complait à digresser sans tenir compte du lecteur, partager les deux ou trois idées marquantes pour soi pendant cette lecture, c’est aussi s’approprier une œuvre : après un arpentage, on en pense quelque chose. Et c’est possible, et même autorisé aux personnes qui ne seraient pas bac+12 de la discipline à laquelle est rattachée cette œuvre.
Histoire
La plupart des ressources existantes sur Internet présentant l’arpentage indique que cette méthode est issue des cercles ouvriers du XIXème siècle. Ainsi les mineurs se réunissaient après une longue journée de labeur pour lire ensemble Marx à la lueur de la bougie.
En fait, c’est Jean-Claude Lucien, militant du mouvement Peuple et Culture, qui a conçu des ateliers lecture dans les années 1980-1990. Dans ces ateliers, il proposait aux participants de lire un texte ou un extrait de livre et puis d’en discuter ensemble. Il utilisait différentes technique d’animation pour animer cette discussion, et a intitulé ces ateliers des « arpentages ». Peuple et Culture continue d’explorer un travail d’éducation populaire autour de la lecture.
Deux personnes, Christophe Chigot et Anthony Durroy, participent à un de ces arpentages en 2002. Séduits par le principe, ils décident d’animer, à leur manière, d’abord ensemble puis chacun de leur côté, des arpentages dans leurs propres réseaux, en variant les formes d’animation – 2 heures, une nuit, 2 jours… – et le type de lectures arpentées. Anthony va arrêter et Christophe va s’installer dans cette pratique, et proposer tous les mois des arpentages dans les cafés-lecture pendant 4 ans (plus d’infos sur ce réseau ici : https://resocafecantineasso.fr/) et au sein du réseau des CREFAD (https://reseaucrefad.org/).
Dans ses premiers ateliers, au cours des années 2000, c’est parfois une série de livres et de textes qui sont proposés à la lecture, sur un thème. Lorsque l’atelier est consacré à un livre, Christophe le photocopie intégralement, pour que chaque personne puisse en lire une partie.
Et, un jour, les photocopies ne sont pas faites. Au pied du mur, il décide de déchirer le livre pour que l’atelier puisse quand même se tenir. Ensuite, selon les situations, il lui arrive de ré-utiliser cette idée de déchirer le livre à lire, notamment pour la discussion que ce geste provoque. C’est aussi un gain de temps : c’est long de photocopier l’intégralité d’un livre.
Christophe Chigot va alors former des personnes et des équipes à cette méthode, comme la SCOP Le Pavé ou Pivoine, qui vont découvrir l’arpentage au début des années 2010. Le Pavé va largement diffuser l’arpentage au travers de ses formations, en insistant sur la nécessité de déchirer le livre comme acte symbolique fort dans le rapport aux savoirs. Les autres SCOP d’éducation populaire vont aussi se saisir de cet outil qui va ainsi se diffuser largement dans les réseaux militants associatifs français.
Au début des années 2020, l’arpentage est présent dans de nombreux milieux sociaux différents, bien au-delà du champ socio-culturel. L’engouement est tel que des médias nationaux s’intéressent à l’arpentage : vous trouverez ainsi en bas de cette page un lien vers un article de Libération et une émission de radio de France Culture consacrée à l’Arpentage.
Préparation
L’animateur ou les participants choisissent le ou les textes qui seront arpentés. Il n’est pas nécessaire que l’animateur ait lu ces textes avant, c’est même une garantie qu’il ne va pas chercher à guider le groupe vers « ce qu’il faut avoir compris ».
Il va s’agir de rendre un temps de lecture confortable. Selon les personnes, le confort prend un sens bien différent : s’isoler ? avoir quelque chose à grignoter ? pouvoir stabyloter ? Assis ? Couché ?
Puis de rendre une discussion autour d’une lecture dynamique et inclusive, c’est-à-dire de faciliter les apports potentiels de chaque participants à la discussion. Donc définir d’éventuelles consignes de lecture et de discussion en fonction du contexte, du temps, de l’endroit, des intentions et de la composition du groupe.
Animation
Découvrir ensemble un livre, avant de le lire
Un arpentage commence par une discussion collective : il s’agit d’échanger sur ce que l’on pense qu’on va vivre comme moment de lecture. Pour cela, on invite chacun à commenter le livre sans l’ouvrir, c’est-à-dire à partir du titre, de la taille du livre, de l’éditeur, du prix, de l’auteur, de la couverture, de l’épaisseur du livre… bref, des informations que l’on a sur le livre sans l’ouvrir. Pense-t-on qu’on va s’ennuyer, souffrir, être perdu, rêver, réfléchir, voyager… ?
Que pense-t-on trouver dans ce livre ? Cette discussion permet aux plus sachants de partager ce qu’ils savent de l’auteur, de la maison d’édition, de la collection, du courant littéraire auquel appartient ce livre, etc. Je renvoie ici à un excellent livre, qui pourrait bien être le premier à arpenter pour un groupe souhaitant pratiquer cette méthode, et encore plus pour l’animateur : comment parler des livres que l’on n’a pas lus ? (le lien pointe vers la présentation de ce livre sur le site de l’éditeur)
Cette discussion peut se poursuivre à partir d’une découverte collective du quatrième de couverture et du sommaire, de la police et de la mise-en-page. Bref, des informations que l’on a en s’approchant du livre mais toujours sans commencer la lecture. Les ressentis sont toujours les bienvenus : « c’est gros, c’est écrit petit, il y a des notes de bas de page, ça doit être chiant ».
Se partager la lecture, et lire !
Puis vient le moment difficile pour certains où le livre va être déchiré en autant de morceaux qu’il y a de participants. Il est aussi possible de partager le livre entre des binômes, pour que 2 personnes aient lu chaque morceau. Ce n’est pas gênant qu’une partie commence ou finisse au milieu d’une phrase, c’est possible aussi de distribuer des chapitres. On peut donc aussi photocopier le livre ! Ou en avoir un exemplaire par personne.
Si un livre est déchiré, une discussion peut aussi se lancer là autour de ce geste : le livre est sacré, la lecture est sacralisée, ce geste n’est pas anodin. Lors d’un premier arpentage, ça peut même être nécessaire : ce geste peut provoquer des émotions fortes, vis-à-vis du prix du livre, de son rapport à l’école, aux savoirs, à la censure… Pourtant, combien de livres finissent au pilon sans même être ouverts ? Il peut être utile de distinguer déchirer un livre pour le lire et le brûler pour l’interdire.
C’est alors parti pour le temps de lecture. La durée peut être très variable : des arpentages sont conduits sur 2 jours, c’est aussi possible en deux heures. Ça ne donne pas la même chose bien sûr. Ce n’est pas grave si ce temps ne permet pas de lire l’intégralité de sa partie, mais entrer dans un texte demande un temps minimum, de 30 à 45mn disons. Il peut aussi y avoir plusieurs allers/retours entre lecture et discussion !
En discuter ensemble
Selon l’animation, il est possible de donner des consignes de lecture, ou non, du type : noter des phrases marquantes, des idées fortes, ses désaccords, ses questions… Les noter sur des post-it permet de les coller sur les pages du livre au fil de la lecture puis, pendant la discussion, de les coller sur un support collectif.
J’invite à distinguer, dans les consignes de lecture possibles, celles qui renforcent un rapport scolaire à la lecture, en invitant à noter, puis partager, le contenu de ce qu’on a lu et ce qu’on en a compris, et les consignes qui s’écartent de ce rapport scolaire à la lecture du type : ce que j’ai ressenti en lisant, ce à quoi cette lecture m’a fait penser, ce qui m’a énervé, ce qui m’a plu, ce que je pense de l’auteur ou du livre après ce temps de lecture. Ce type de consignes ne nécessite d’ailleurs souvent aucune prise de notes pendant la lecture.
Vient alors le temps des retrouvailles en groupe et de l’échange autour de ce temps de lecture. Il y a alors évidemment de nombreuses variantes : il peut y avoir, ou non, une prise de notes de cette discussion, pour faire une fiche de lecture de ce livre.
Les réponses individuelles aux éventuelles consignes peuvent être écrites sur des post-it qui seront ensuite affichées sur des panneaux au fur et à mesure des prises de paroles. Les prises de parole peuvent être liées à la chronologie du livre ou bien à bâton rompu.
En proposant aux participants de noter sur des post-it des mots, des phrases autour de quelques concepts forts d’un livre, il est ainsi possible par exemple, de construire ensuite collectivement des cartes mentales de ces concepts et de se les approprier beaucoup plus facilement et finement qu’en lisant seul ce livre !
Cependant, il est dans tous les cas utile de démarrer cette discussion par un temps de ressenti dans lequel on ne discute pas du fond du livre mais des émotions traversées pendant ce temps de lecture. Ce temps permet de dire si la lecture était facile ou difficile, agréable ou désagréable, intéressante ou non, etc. Je n’ai pas trouvé de meilleure modalité pour ce moment que la discussion à bâton rompu.
NdlR
Ce qui est étonnant dans un arpentage, c’est que j’ai toujours eu l’impression de mieux saisir le sens d’un livre, et de m’en souvenir, lorsque les consignes de lecture n’incitaient pas à restituer ce qu’il faut avoir compris de chacune des parties.
Lorsque chaque personne peut dire les questions, les doutes, les émotions avec lesquelles elle ressort de ce temps de lecture, j’ai toujours trouvé une profondeur dans l’appropriation collective d’une œuvre que je ne retrouve pas lorsqu’il est demandé à chaque participant les 3 idées fortes du passage qu’il a lu.
Et, étrangement, en ne partageant que des ressentis sur des morceaux du même livre, une alchimie s’opère et chacun a le sentiment de s’être mieux approprié le contenu de ce livre que s’il l’avait lu in extenso lui-même.
Et en plus, en axant sur les questions, les doutes et les émotions, chaque personne peut plus facilement prendre sa place dans la discussion que lorsqu’il s’agit de restituer le contenu de sa partie, qui met en avant les bons élèves.
Pour moi, la puissance de l’arpentage, c’est de pouvoir s’émanciper d’un rapport au savoir douloureux pour bon nombre de personnes. En miroir, l’écueil d’un arpentage, c’est de proposer de faire un résumé des idées contenues dans son morceau de livre puis de devoir en dire des choses intelligentes devant les autres participants.
Ressources
- Une interview de Jean-Claude Lucien, initiateur de cette méthode faite par Peuple et Culture . Le lien pointe vers ce podcast sur SoundCloud. Jean-Claude Lucien présente les origines et les évolutions de l’arpentage, entre apports théoriques et anecdotes.
- Une émission de radio de 10mn sur France Culture consacrée à l’arpentage : https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/le-point-culture/l-arpentage-une-technique-de-lecture-en-groupe-qui-seduit-de-nouveaux-publics-3864471
- Un article sur Libération (lecture réservée aux abonnés) : https://www.liberation.fr/idees-et-debats/arpentage-jaime-lidee-de-dechirer-les-livres-cest-un-geste-fort-pour-les-desacraliser-20230511_OP6LKO4YTNGDVNZGKXM3JLV2UU/
Voici plusieurs fiches détaillant la conduite d’un arpentage :
- La fiche produite par Pivoine :
- La fiche produite par Peuple et Culture :
- La fiche produite par le CIEP :
- et cette page en PDF !
